L'équité des services éducatifs et pouvoirs organisateurs : Questions sociologiques sur la décentralisation du système éducatif au Maroc Rachid Bekkaj
le traitement du système éducatif au Maroc est associé à la décentralisation, ce qui requiert une approche globale qui aboutira à une école interconnectée dans un environnement interconnecté. Il est indéniable que cette approche intègre à la fois les aspects scientifiques, culturels et politiques pour guider l'apprenti dans la bonne direction.
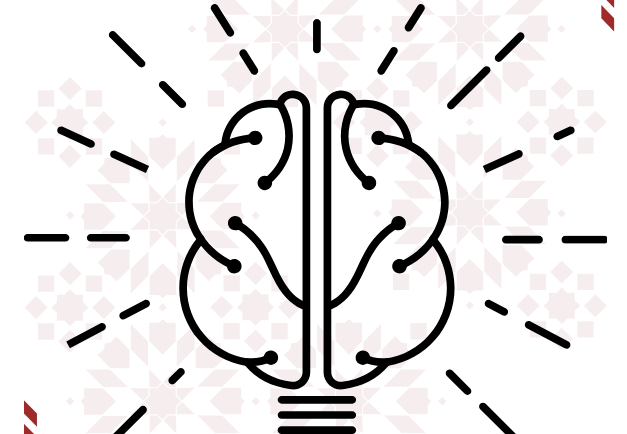

L'équité des services éducatifs et pouvoirs organisateurs : Questions sociologiques sur la décentralisation du système éducatif au Maroc
Rachid Bekkaj Sociologue
Aujourd’hui, plus que jamais la situation du système éducatif au Maroc est qualifiée dans le discours politique comme le sujet majeur. En sciences sociales le traitement du système éducatif relève du domaine de la sociologie politique, et avec les recherches que se sont développées dans les domaines de l’intégration sociales, le sujet est devenu une des thématiques les plus traités en termes de développement sociale.
Depuis l’indépendance l’éducation nationale a connu certains reformes, pour répondre aux besoins de la demande de la société, mais aujourd’hui elle constitue un domaine de réforme par les institutions internationales. Nous faisons références ici à la relation de système éducatif avec les organismes internationaux. La banque mondiale s’est intéressée de près à la réforme de ce système, dont elle a livré une évaluation pas tellement positive (1). Chez les responsables la situation est considérée comme un gênant ainsi que la mise en avant d'une explication ou la recherche des causes de cette situation. Avec ce que dévoile la réalité de ce système se produit une attitude que nous pouvons appeler « attitude de mise en cause », ou « attitude de plainte » ou « attitude de dénonciation ».
La première observation que le chercheur retient dans ce domaine c’est l’aspect moins abordé, qui est la recherche et la mise en place de propositions concrètes venant de l’analyse concrète, afin de tenter à résoudre les problèmes posés en amont et non dans l'après coup ou en aval (2).
De ce fait, pour mettre la lumière sur telle réalité et pour mieux comprendre la raison sociologique qui nous conduit à s’interroger sur ce sujet il est nécessaire de répondre à certaines questions qui semblent importantes et qui s’imposent encore plus aujourd’hui.
a) Question de l’avenir :
Il est probable que les futures générations du Maroc se questionnent pendant longtemps sur la signification réelle à donner aux rendez-vous manqués du développement de leur pays au cours des années précédentes. Bien sûr, la solution réside dans le système éducatif adopté par les dirigeants du secteur. Depuis le protectorat jusqu'à aujourd'hui et au fil des années, le sujet n'a pas été à la bonne voie (3).
b) La question fondamentale des professionnels des parents et chercheurs scientifiques en sociologie
en l’occurrence :
- Question sur l’éducation institutionnelle, c’est-à-dire comment aider les élèves à entrer dans un processus d'apprentissage relationnel, leur permettant une intégration sociale politique économique et culturelle ?
- De quelle manière peut-on créer l'élite de l’avenir ?
L’histoire des universités au Maroc ont été le théâtre d'actes de violence de toutes sortes. De nombreuses d'entre elles sont devenues le théâtre de combats, de guérillas presque permanentes (4). La violence universitaire prend diverses formes, telles que les conflits entre groupes d'étudiants ayant des idéologies différentes, la violence structurelle et les violences de genre, Il ne faut pas négliger les grèves pour des recommandations étudiantes. La situation à la faculté de médecine comme exemple
Quant au bilan pédagogique, il est simple de le faire : certains établissements universitaires rendent compte du nombre d'heures réellement enseignées dans les modules d'enseignement au cours de l'année.
Les défis d’étude de la décentralisation du système éducatif
Il convient tout d'abord de souligner sur le plan épistémologique que l'étude des différents concepts employés pour aborder le sujet de la décentralisation du système éducatif est une question très scientifique (5).
Le chercheur est parfois confronté à l'ambiguïté de la terminologie utilisée dans le contexte de la décentralisation du système éducatif (6). Par exemple, je cite : « Éducation urbaine », « Éducation régionale », « Éducation indépendante ». Le terme « éducations territoriales » implique effectivement que l'éducation nationale reconnaît les disparités, tandis que le terme « éducation locale » aborde la question de la logique de gestion de l'administration éducative, et le troisième aborde la question des moyens entre conformité administrative d'une part et méfiance envers la bureaucratie publique d'autre part. Cela suscite une réflexion sur la façon dont l'approche scientifique abordera le sujet.
La décentralisation, une question sociologique
J'aimerais contribuer à la question de la décentralisation du système éducatif en soulignant divers aspects sociologiques. La structure scolaire est un lieu de relations multiples et un système où chaque élément représente une structure presque autonome à étudier de manière indépendante(7) :
Dans un premier temps, il est question de mettre en pratique l'importance des aspects sociologiques de la décentralisation du système éducatif au Maroc, ainsi que de la décentralisation en tant que stratégie de développement de l'enseignement dans une société en constante évolution. Ainsi, cette contribution aborde le sujet de la décentralisation et des pouvoirs locaux en matière d'éducation et d'enseignement.
Dans un second temps, il s'agit des interrogations liées aux perspectives de la décentralisation du système éducatif qui permettent de réfléchir à cette question. Ce sujet apparaît très important ces dernières années et est à la fois lié à la sociologie politique et à la sociologie du développement.
La décentralisation de l’enseignement est primordiale (8). L’importante de noter que ce n'est pas uniquement un problème du milieu urbain, mais un sujet qui englobe à la fois le milieu rural et le milieu urbain (9). Il semble donc nécessaire d'avoir une ouverture macrosociologique qui propose une gouvernance politique de la décentralisation dans le cadre local et national (10).
Deuxièmement, ce sont des questions liées aux perspectives de décentralisation du système éducatif, et cette question peut être réfléchie.
Ce sujet est devenu de plus en plus important ces dernières années et concerne à la fois la sociologie politique et la sociologie du développement.
Il est important de noter qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème urbain, mais d'un problème qui touche à la fois les zones rurales et urbaines .
Toutefois, selon Durkheim, la société ne pourrait pas être indifférente lorsqu'il s'agit de l'éducation (11). Il apparaît donc indispensable d'adopter une approche macrosociologique qui propose un contrôle politique de la décentralisation dans les contextes locaux et nationaux.
Centres d’intérêt social de la sociologie de la décentralisation du système éducatif ?
Avec la décentralisation du système éducatif trois éléments importants se mettent en surface et qui seront l’objet de débats et d'analyse :
a) la phase de recomposition des identités et des rapports professionnels entre les dirigeants des établissements scolaires et les cadres des pouvoirs organisateurs (12).
b) la phase de la compétition et de la démarcation :
il s’agit dans cette phase de la diversité de l’offre de services singuliers propres à chaque établissement et sa relation avec le projet d’établissement comme intermédiaire (13).
c) la phase de la responsabilité du pouvoir et organisateur de système éducatif en face de la qualité générale de l’éducation auprès de leur population respective (14).
C’est à partir de ces axes que la sociologie de la décentralisation du système éducatif aborde ce sujet en constituant l’objet de questionnement scientifique et la matière d'analyse sociologique.
Décentralisation du système éducatif et l’approche participative
a) Contexte sociologique de la décentralisation du système éducatif
1-L’échec de l’ancienne pédagogie :
Pour mieux comprendre la réalité de la situation du système éducatif aujourd’hui comme dans le passé depuis l’indépendance, il est nécessaire de comprendre l’échec de la pédagogie suivie jusqu’à présent. Dans ce cas, il faut aller dans le sens d'une approche sociologique compréhensive telle que l'avait inaugurée Max Weber, c'est-à-dire mettre l’accent au sens subjectif que les acteurs investissent dans leurs conduites (15). Finalement, les résultats des réformes du système éducatif au Maroc ont été globalement décevants au regard de l’amélioration de la qualité de l’éducation nationale qui avait été promise lors de leur lancement. La lecture de système pédagogique montre que l’enseignant au lieu d'attitudes d'appropriation du savoir, celui-ci mobilise ainsi des attitudes de conformité aux consignes données.
2- Rupture entre l’apprenti et son milieu social et culturel
A l'école souvent les professeurs sont branchés aux programmes que doivent être terminés sans avoir compte des changements d'exigences que subissent leurs élèves, notamment d'origine populaire et rurale. Un processus de déracinement dont les élèves résistent puisqu'ils sont attachés et leurs contextes socioculturels d’où ils refusent de s'extraire. Or, si ces derniers ont bien conscience des inégalités socioculturelles initiales, ils croient souvent qu'il suffit qu’ils essaient de mettre les élèves en présence d'objets culturels pour présenter ça comme solution. Or, c'est bien souvent le problème d'identité qui se pose le moment on fait plonger les élèves dans un univers différents et donc peu familier. Cette situation a été constatée scientifiquement et qui explique «ce qui amène les élèves à assimiler toute séance similaire à une activité déconnectée de l'apprentissage scolaire"(16).
3- Mauvaise gestion des champs éducatifs
L’observation sociologique du système éducatif au Maroc mit l’accent sur deux éléments indicateurs de la mauvaise gestion :
- La division sociale sexuelle du travail :
L’analyse de la profession dans le domaine de l'éducation nationale en général, et de l’enseignant en particulier a montré que le système éducatif s’appuie sur la division sexuelle du travail, instituant un double régime de domination subordination. Administrateur inspecteur enseignant portent une image sociale sexuelle de la femme. . L’évolution de son rôle ou de ses missions comme femme est mise en lien avec le développement éducatif, culturel et technologique de la société marocaine.
- L’échec scolaire
L’échec scolaire est la raison d’être des professions de l’éducation, Les élèves qui ont raté leur parcours scolaire est quasiment devenus une « nouvelle » catégorie sociale, se normalisant sous les effets socialisants de l’enseignement et des méthodes de gestion dans le domaine.
- Le souci du respect du programme de l’enseignement national est l’un des indicateurs de la mauvaise gestion. C’est pour cette raison nous pouvons qualifier cet indice comme grand défi de la décentralisation du système éducatif
b) Dispositions sociologiques de la décentralisation du système éducatif
Si les processus de décentralisation du système éducatif permettent de résoudre la question de la qualité de l’enseignement, il faut dire aussi pour assurer la participation politique sociale culturelle des acteurs sociaux et politiques aux différentes échelles locales, il faut :
a) Installer des mécanismes d’échange nécessaire sinon obligatoire de composants des unités sociales vers des collectivités territoriales autonomes pour une meilleure communication.
Ainsi l’opérationnalisation dans les secteurs infra‑étatiques relative à la réalité de chaque région et en rapport avec de tous les autres paramètres de la bonne gouvernance pourront être réalisées à partir de cette démarche.
b) Les stratégies de développement participatif et de développement local acquièrent dans cette perspective une dimension plus large. La vision que pourront adopter les responsables du système éducatif doit être développée en fonction de moyen terme et de longs termes. L’éducation n’est pas une responsabilité des familles seulement mais de l’Etat et avec priorité.
Dans ce sens il est nécessaire de faire retour aux composantes suivantes :
a) Qu’est-ce qu’un l’élève
La définition soulève fréquemment des interrogations concernant l'identité et le fonctionnement de l'élève. Est-ce qu'il s'agit d'un individu indépendant de son identité sexuelle ? Est-ce que l'élève fait allusion à une période transitoire ? Le terme « élève » n'a-t-il pas une connotation idéologique qui dissimule la distinction entre « les élèves » plutôt que de la prendre en compte ? Pourquoi considérer l'élève comme un individu qui est contraint de suivre un programme sans avoir à donner son avis ? Comment reconnaître que l'enfant est un être humain ayant ses propres besoins, ses pulsions, sa liberté de parole, de jouer, de se déplacer, de courir. et de penser autrement?
Ces interrogations jouent un rôle crucial dans la recherche scientifique. Particulièrement parce qu'elles nous posent la question de la finalité et de la responsabilité de l'institution scolaire face à l'échec de l'élève (17).
L’élève ou l’apprenti est un produit social de son milieu
Il est fréquent de faire référence pour situer l'origine de l’échec de l’élève dans la difficulté des parents qui n’arrivaient pas à suivre le processus de la scolarisation de leurs enfants pour plusieurs raisons, surtout des raisons économiques (18). Les parents pauvres vivent les privations, à faire vivre à leurs enfants des contraintes, des frustrations et des interdits.
Chez les parents qui ont les moyens on trouve un autre problème qui réside dans les conditionnements consuméristes, qui pèsent surtout sur l’imaginaire comme aussi sur les comportements des enfants.
Il est nécessaire de signaler dans ces contextes le pouvoir des multinationales dans le domaine publicitaire qui visent les représentations sociales et l’imaginaire des enfants. La publicité est n’est pas seulement un moyen pour transmettre l’information, elle n’est pas socialement neutre, mais c’est une usine sociale de l’être du désir et l’être du plaisir de l’instant, une socialisation industrielle qui transforme les enfants en être avec des nouvelles valeurs et par conséquent en êtres qui fuient le réel(19).
Les parents
La responsabilité des parents est primordiale dans l'éducation de leurs enfants, en particulier pendant leur période scolaire. L'étude sociologique de l'intégration de l'élève ne cesse de souligner l'impact des parents sur le parcours de vie de chaque enfant, sur ses expériences de vie, sur sa capacité à participer et à intégrer des savoirs (20).
Il est donc essentiel de mettre l'accent sur l'implication des représentants des parents dans les écoles. La réussite de la décentralisation ne peut être garantie que par l'engagement des représentants des parents d'élèves, chargés de promouvoir les échanges entre parents d'élèves, enseignants et direction.
La situation est devenue encore plus complexe avec la famille d'aujourd'hui où les problématiques des parents retentissent plus directement sur les enfants et dans les différentes étapes de leur vie.
Dans le passé, pour un enfant la possibilité de se dire, d'être entendu par un grand père, un oncle, était fréquente. Aujourd'hui dans la famille dite nucléaire ou reconstituée, il est plus difficile semble-t- il de trouver un interlocuteur, avec qui parler. L’enfant décide sa vie depuis l’école (21)
L’enseignant
L’intérêt donné à l’enseignant relève de son rôle dans le système éducatif. L’analyse de son travail dévoile une réalité demeure cachée. L’enseignant est confronté à la difficulté de transmettre un enseignement uniformisé, pouvons-nous dire aussi formaté, à des populations d'enfants non homogène à la fois masculin et féminin. Ce qui laisse dire et par conséquent qu’on a sacrifié l'équité à l'égalité.
Dans les écoles les inégalités existent encore et partout. Les sociologues parlent déjà des inégalités sociales depuis la maternelle. Puisque la maternelle est la première école qui doit préparer les plus jeunes élèves à accomplir une scolarité de plus en plus longue (22).
En observant dans trois classes et en interrogeant les enseignants et les élèves pour évaluer le temps de parole de l'enseignant pendant un cours, nous avons remarqué que l'enseignant prend la parole beaucoup plus que tous les élèves réunis. Ceci témoigne de notre absence d'une pédagogie active qui offre aux élèves la possibilité de réagir librement, de trouver des réponses à des questions où il existe de nombreuses options, et de favoriser un échange horizontal plutôt que vertical.
Dans cette perspective, évaluer les méthodes de l'enseignant en classe nécessite nécessairement une remise en question et une recherche d'amélioration. Cela implique de mesurer l'importance des enseignants dans un processus de décentralisation, et dans cette perspective, il est également nécessaire de comprendre la crise du système éducatif au Maroc.
Pouvoir organisateur
Le système éducatif au Maroc reste néanmoins encore fortement centralisé. Le ministère est toujours en charge de l’essentiel du curriculum national ainsi que du recrutement des personnels. Les pédagogies sont définies comme des méthodes d’organisation et de gestion de l’enseignement et de l’apprentissage, ayant pour finalité de faciliter le conformisme. Ainsi, l’apprentissage n’est pas le résultat obtenu seulement par l’enseignement depuis la maternel (23), mais il est le résultat d’une démarche politique d’où le corps enseignant n’est qu’un exécutant.
On doit déplacer la problématisation des rapports entre connaissance savante et connaissance ordinaire dans les sciences sociales, dans le sens de la triple reconnaissance de continuités, de discontinuités et de va-et-vient entre les deux registres.
Quels sont les démarches
- Être attentif aux apprentis : Dans cette optique, il est essentiel de se concentrer sur la manière dont ils apprennent, construisent ou reconstruisent les connaissances pour leur propre compte.
- Inciter l'enseignant à ne plus se limiter à la transmission.
D'après ce point de vue, il ne faut pas se contenter de la transmission du savoir, mais de prendre en considération la complexité des situations d'enseignement-apprentissage, en offrant à l'apprenant une activité active de résolution de situations d'apprentissage par le biais de tâches, en s'appuyant sur des acquis scolaires antérieurs et des expériences de vie pour les impliquer.
- Traverser le monopole de l'enseignement
Dans cette situation, nous sommes contraints de renoncer aux aspirations de la domination pédagogique par le pouvoir central, c'est-à-dire les administrateurs de la métropole. En intégrant les responsables locaux, à la fois comme un frein (intérieur) à la décentralisation du système éducatif et comme un soutien, voire un moteur de la dynamique de la mise en œuvre efficace de cette décentralisation.
Conclusion
Pour résumer, on peut affirmer que le traitement du système éducatif au Maroc est associé à la décentralisation, ce qui requiert une approche globale qui aboutira à une école interconnectée dans un environnement interconnecté. Il est indéniable que cette approche intègre à la fois les aspects scientifiques, culturels et politiques pour guider l'apprenti dans la bonne direction.
Ce n'est donc pas un simple travail d'expertise technique ou scientifique qui permettrait de décentraliser le système éducatif, mais un processus social et politique d'autant plus ouvert à la situation sociologique. Toute approche dans cette optique ne se restreint pas à une problématique technique avec des limites souvent pas vraiment définies, mais elle s'inscrit également dans les divers enjeux économiques politiques et sociaux, c'est à dire selon des intérêts sociologiques étendus.
Bibliographie
1) La Banque mondiale renforce son appui au secteur de l’éducation au Maroc
2) Sut la question scientifique et sa particularité voir Popper K., Logic der Forschung, Springer, Wien, 1934. Traduction française : Popper K., Logique de la découverte scientifique, Payot, Paris, 1973,
3) Yvonne Knibiehler, L'enseignement au Maroc pendant le protectorat (1912-1956). Les « fils de notables » dans Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine Année 1994 41-3 pp. 489-498
4) Yassine Benargane, Histoire : Plus de deux décennies de violences au sein des universités marocaines
https://www.yabiladi.com/articles/details/65217/histoire-plus-deux-decennies-violences.htm
5) Gilles Willettn, Paradigme, théorie, modèle, schéma : qu’est-ce donc ?
https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.1873
6) Christophe Roche, Le terme et le concept : fondements d’une ontoterminologie, In « Terminologie & Ontologie : Théories et Applications » - Annecy 1er juin 2007, pp1-13
7) Marcel Postel, la relation éducative, 3 Ed, PUF,Paris,1986,p 23
8) Ismail Ferhat, Comment se positionner face à la décentralisation du système éducatif ? L'exemple de la FEN de 1968 à 1992, Pages 141 à 157
https://shs.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2014-1-page-141?lang=fr
9) Khalid Gueddari, L’école en zone rurale au Maroc
https://shs.cairn.info/revue-cahiers-pedagogiques-2018-3-page-6?lang=fr
10) Jacques Lautman Attraits et périls de la macrosociologie historiquen, Pages 139 à 145
https://shs.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2007-HS-page-139?lang=fr
11) Durkheim, E, Education et sociologie, Quadrigen PUF, 2° Ed, Paris, 1989 ; PP 58-59
12) Guy Rocher, Introduction à la sociologie générale, Vol 1 ( Action sociale) Ed HMH , Paris 1968, pp161-166
13) Luc Prud’homme, et autres, La légitimité de la diversité en éducation : réflexion sur l’inclusion, In Valorisation de la diversité en éducation : défis contemporains et pistes d’action, Volume 39, numéro 2, automne 2011 p. 6–22
14) Stéphane Germain, Le management des établissements scolaires, Chapitre 4. Comprendre la gouvernance du système éducatif, Pédagogies en développement, 2018 Pages 157 à 185
15) Voir Max Weber, Economie et société, 1921 (traduction française) : Plon, 1971
16) Altet, M. Les pédagogies de l’apprentissage. Paris : PUF ; 2013
17) Séverine Haiat, Gaelle Espinosa et Annie Charron, La relation enseignant-élèves au cœur de la réussite éducative,
https://doi.org/10.4000/edso.22736
18) Christophe Joigneaux, « La construction de l’inégalité scolaire dès l’école maternelle », Revue française de pédagogie, 169 | 2009, 17-28.
19) Mialaret, G , Pédagogie générale Résonnances, Paris, PUF ; 1990
20) Christophe Joigneaux idem
21) Emile Durkheim, Suicide, Etudes sociologiques, PUF, 1930
22) Rachid Bekkaj, Dix questions sociologiques au Maroc contemporain, Ed Somagram, Casablanca, 2010, P85
23) J.R.R. Tolkien, La culture du pauvre, Minuit, 1970 dont la traduction du titre trahit quelque peu l'original : The Uses of Literacy : Aspects of Working Class Life, Chatto and Windus, 1957
